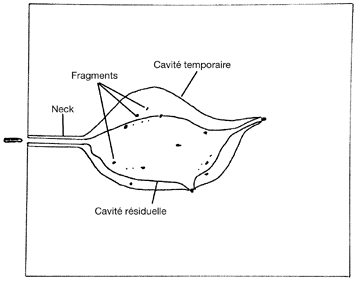TPE - Police Scientifique

BALISTIQUE
La balistique est une science qui permet d’étudier le mouvement des projectiles. D'un point de vue criminalistique, il s'agit d'exploiter tout ce qui concerne les armes à feu et leur utilisation. Elle permet de déterminer la nature de l’arme ayant causé une blessure ou la mort, mais également la direction, la distance de tir et le nombre de coups de feu tirés. Entre l’instant où il est tiré et son impact sur la cible, le déplacement d’un projectile comporte trois phases :
- la balistique intérieure, traite du déplacement du projectile dans le canon.
- la balistique externe, traite de sa trajectoire.
- la balistique terminale, qui relève des effets du projectile sur la cible.
Pour cela on va donc rechercher l’arme qui a tiré la balle. Une fois celle-ci retrouvée, si elle et la balle sont compatibles on pourra donc, retrouver le tireur. En effet, chaque arme possède un numéro de série, associé à un port d’arme qui permettra de retrouver le propriétaire de l’arme. Les enquêteurs font appel à un spécialiste, le balisticien, quand une arme à feu a été utilisée sur la scène de crime. Il se concentre alors sur quatre points : les balles, les douilles, les traces de résidus de poudre et finalement l’arme elle-même.
I – La balistique interne (ou intérieure)
Elle comprend tous les phénomènes se réalisant à partir de la mise à feu de la charge explosive (poudre), jusqu’à la sortie de la balle du canon. Elle s’intéresse également, à la taille, au diamètre, à la quantité de poudre, ainsi qu’à la masse de la cartouche. Toutes balles présentent des stries qui les rendent uniques, ce qui permet à la section balistique de les étudier. Une balle tirée par une arme provient toujours d’une munition. Celle-ci, est constituée d’un étui rempli de poudre fermé par une balle.
(1) Le culot
(2) L’amorce (déclenchera l’explosion)
(3) La poudre
(4) La douille
(5) La balle
Afin que celle-ci parte en ligne droite et atteigne sa cible, elle est forcée de tourner sur elle-même. A l’intérieur du canon, il existe des rayures en formes de spirales qui provoquent ce mouvement. Le diamètre de la balle est légèrement supérieur à celui du canon, par conséquent, la balle va y entrer en force et se mettre à tourner sur elle-même tout en suivant les rayures dont le relief s’incrustera sur la balle. En étudiant le nombre de rayures, leurs inclinaisons et leurs largeurs, il sera possible d’identifier le modèle de l’arme qui a tiré la balle.
On peut également utiliser la formule mathématique de l’énergie cinétique très utile pour retrouver une munition particulière :
E = ½ m v² (avec m en kg, v en m/s et E en J)
Ainsi, une balle de 8g percutant une cible à une vitesse de 350m/s a une énergie cinétique de 490J.
En effet, la portée d’une arme (distance à laquelle on peut atteindre sa cible) ainsi que les dégâts que la balle va provoquer dépendent de 3 paramètres:
- La masse de la balle, (l'énergie donc les dégâts provoqués y sont proportionnels).
- La vitesse de la balle, (l'énergie est proportionnelle à la vitesse au carré).
- La forme de la balle, (balle blindée, à expansion...).
Chaque arme marque d’une façon particulière les balles, elle possède son identité propre. Cela permet de savoir sur une scène de crime si une ou plusieurs armes ont été utilisées. Chaque balle possède des sillons ou des stries visibles sur la surface de la balle, caractéristique de l’arme utilisée et de la morphologie de canon de l’arme. En général, elles mesurent entre 0.5 et 2 mm de large.
Pour cela, le balisticien compare les projectiles avec le système ibis. Les balles et les projectiles trouvés sur chaque scène de crime sont numérisés. Ils sont enregistrés dans une base de données qui permet de comparer les marques d’un projectile suspect avec d’autres affaires criminelles. Donc le système Ibis est essentiel pour résoudre un crime, car il permet de relier des crimes entre eux.
Puis au macroscope, il compare les types de trace. Le macroscope est un microscope de comparaison avec deux objectifs ce qui permet de comparer deux objets simultanément. Pour comparer les balles, il fait glisser les images jusqu’à ce que les marques semblent continues. S’il y a une juxtaposition, l’expert conclut alors que la même arme a tiré les deux projectiles.
Pour vérifier que le projectile trouvé sur la scène provient de l’arme suspecte, on doit le comparer avec un autre projectile. Pour cela, l’expert tire dans un puit spécial rempli d’eau, dans un tube d’acier rempli de coton ou encore sur un gel balistique qui permet de freiner le projectile et donc de le récupérer sans dommage. Puis, après avoir récupéré le projectile, l’expert le compare avec le projectile prélevé.
Si l’expert a repéré une correspondance, alors il fait tourner les deux balles dans la même direction et à la même vitesse pour voir si d’autres marques apparaissent simultanément. L’expert augmente le grossissement du macroscope pour vérifier si les marques plus petites sont aussi alignées.
Mais la procédure n’est pas une science exacte. Deux balles ne sont jamais exactement les mêmes, elles peuvent avoir subi des marques particulières quand elle a atteint la victime ou heurté un objet. Le canon présente aussi différentes particules de poussière qui laissent différentes marques sur les balles.
Cependant, sur une scène de crime, la balle n’est pas toujours retrouvée : elle peut ressortir du corps de la victime, ou encore, être détruite lors du choc causé par l’impact. Dans ce cas, une identification est impossible. Il est alors nécessaire de rechercher la douille. Chaque arme est unique, c’est pourquoi, à chaque détonation, elle laisse des micros stries qui lui sont propres, sur le culot de l’étui. De cette façon, on peut facilement associer un projectile à une arme. Cette dernière a une identité qui lui est propre.
Lorsque le percuteur frappe l’amorce, la poudre s’enflamme et les gaz se détendent. La balle est alors éjectée. Elle part dans un sens contraire à celui de l’étui qui est expulsé sur le côté. On note également que les traces laissées sur l’amorce par le percuteur ainsi que celles laissées par le mécanisme d’éjection sur le fond de l’étui permettront aussi de reconnaitre par quel modèle d’arme l’étui a été expulsé.
On peut savoir si un suspect a tenu ou actionné une arme récemment en tamponnant leurs mains (la zone palmée entre le pouce et l’index) pour détecter des traces chimiques. La spectrophotométrie, qui permet de mesurer l’absorbance d’une espèce chimique, est utilisée pour chercher les traces de substances présentes dans l’amorce (baryum, plomb, antimoine).
Les fabricants de balles utilisent différentes espèces chimiques pour la substance explosive, donc l’étude de ces substances permettent de trouver le fabricant.
Ce n’est pas une science exacte car :
- S’il n’a pas de poudre sur les mains, alors le suspect n’a pas tiré et est donc disculpé.
- Si on retrouve des espèces chimiques ailleurs que sur la zone palmée entre le pouce et l’index, cela veut dire que le suspect n’a pas tiré mais seulement ramassé l’arme après le tir.
Nous allons maintenant démontrer une formule nous permettant de calculer la trajectoire que peut prendre une balle.
II – La balistique externe
En Balistique externe, une formule est utilisée pour calculer la trajectoire d’une balle, nous allons donc démontrer cette formule. Lors de cette démonstration, les forces de frottements et la poussée d’Archimède seront négligées. Pour un projectile de coordonnées G(x(t) ; y(t)) lancé dans le vide à une altitude y, un angle α, une vitesse initiale V0, et une accélération de la pesanteur g en un temps t, on a la relation : y = 1/2gt² + V0 sin(α)t + y0 ; représentant la trajectoire que prend ce même projectile. Nous allons donc prouver cette relation :
Dans un repère orthonormé, à t = 0, un projectile G (0 ; y0) est lancée à une vitesse initiale V0 .
Or ce projectile se trouve dans un référentiel terrestre, sa vitesse n’est donc pas constante et son accélération n’est pas nul.
III – La balistique terminale
La balistique terminale étudie les effets du tir sur la cible. La gravité d’une blessure dépend bien évidemment de l’endroit où la victime a été touchée mais aussi de la quantité d’énergie libérée, et non transportée, par la balle. Si la balle traverse le tissu sans qu’elle se déforme ou abandonne de l’énergie, la blessure sera légère (sauf dans une zone vitale). Il faut aussi prendre en compte la forme, la masse et la puissance du projectile. De plus, le projectile a un comportement différent s’il est tiré à bout portant, à bout touchant ou à longue distance.
La distance entre la bouche du canon et la cible correspond à la distance de tir. Lorsque le canon est à une distance inférieure de 2 centimètres avec la cible, c’est un tir à bout touchant. Si l’arme est assez proche de la cible pour y laisser des résidus de tir autres que sur la collerette d’essuyage (zone de la cible qui entre en contact avec la balle) et les résidus qui se déplacent avec la balle, c’est un tir à bout portant.
Sur une cible molle ou semi dure, comme le corps humain, deux phénomènes se produisent et il y a formation d’une cavité temporaire et d’une cavité permanente. La cavité temporaire correspond à la désintégration partielle ou complète des organes frappés par le projectile dû au transfert de l’énergie cinétique de la balle aux tissus. Cette énergie peut aussi causer la fracture d’os ou la rupture de vaisseaux sanguins proche de la zone d’impact. Les tissus mous sur la trajectoire du projectile vont être dilatés brutalement avant de revenir à leur état initial. La cavité permanente, ou résiduelle, correspond à la cavité réelle causée p ar le projectile. Elle est constituée de tissu broyé, nécrosé: elle correspond aux lésions définitives.
Lorsque la balle atteint sa cible, elle va former un tunnel d’attrition (neck), c'est-à-dire qu’elle va rester sur une certaine distance en ligne droite. Le tunnel d'attrition est régulier et de diamètre proche à celui du projectile. Ensuite, elle a tendance à se retourner et à être brutalement freiné.